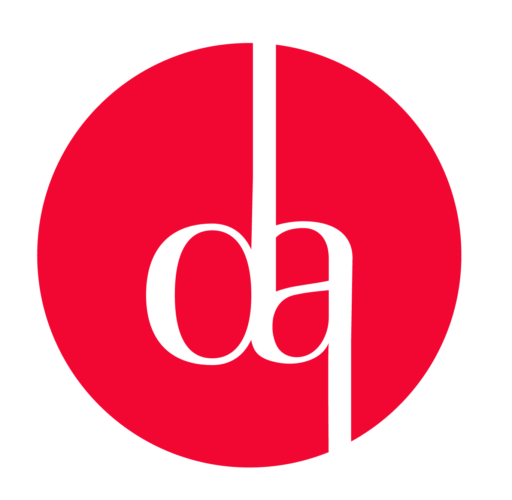En silence ou presque, l’Afrique s’illumine. Pas par ses métaux rares, ses infrastructures ou ses réserves pétrolières, mais par ses récits. Depuis quelques années, l’Afrique connaît un éveil discret, mais spectaculaire dans l’industrie des contenus numériques et audiovisuels. Un secteur longtemps sous-estimé, désormais au centre des convoitises globales. Mais si les projecteurs s’allument, encore faut-il que l’on monte sur scène.
L’Afrique est à un tournant important de son histoire audiovisuelle. L’industrie mondiale de l’audiovisuel devrait dépasser 400 milliards USD d’ici 2028, un signal fort pour les décideurs africains désireux d’anticiper un marché en forte croissance. Actuellement évaluée à environ 5 milliards USD sur le continent, cette filière pourrait générer plus de 20 milliards USD et 20 millions de nouveaux emplois si l’on structure mieux les politiques publiques, les financements et la formation.
Le rôle du secteur privé, et notamment celui des PME, se trouve au cœur de la chaîne de valeur. Ce sont elles qui assurent la vitalité de la kyrielle de métiers – production, postproduction, animation, distribution, doublage, etc. qui forment la colonne vertébrale de cette industrie en pleine expansion. Les films africains se multiplient, les talents émergent, les plateformes s’intéressent. Et pourtant, le chemin reste escarpé. Car derrière le dynamisme, les défis restent légion : manque d’infrastructures, piraterie, financement fragile, peu de politiques publiques coordonnées.
Et pourtant, le vent tourne. Derrière les chiffres impressionnants se cachent des dynamiques. L’Afrique n’est plus seulement un continent de spectateurs. Elle devient productrice d’images, d’univers, d’imaginaires. Le Nigeria, avec ses 2 599 films produits par an, s’impose comme la deuxième industrie cinématographique au monde en volume. Le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda suivent sur le plan continental.
Parallèlement, les usages évoluent. Le marché du streaming vidéo croît à grande vitesse. De 1,8 milliard USD en 2022, il atteindra 3,1 milliards en 2027. Le nombre d’abonnements SVOD passera de 4,9 millions à 13,6 millions sur la même période. En clair, les Africains regardent, produisent et veulent voir davantage de contenus locaux. Le “local” devient un produit d’export. Et cela, les grandes plateformes l’ont compris.
Netflix, Amazon Prime, Showmax investissent. Des talents émergent. Le contenu africain circule. Ce contenu devient également une arme d’influence : le cinéma et l’audiovisuel sont des instruments majeurs de soft power, comme en témoignent les États-Unis avec Hollywood ou la Corée du Sud avec sa K-culture. L’Afrique donc doit saisir cette opportunité stratégique.
Une industrie en mutation, portée par la technologie et la créativité

La technologie accompagne cette dynamique. La réalité virtuelle, les sièges immersifs, les formats ScreenX bouleversent l’expérience cinématographique. L’intelligence artificielle, de son côté, révolutionne l’écriture, le montage, la production. Créer devient plus accessible, plus rapide, parfois même plus ambitieux. Pour les jeunes réalisateurs africains, c’est une libération, on peut rêver plus grand, avec moins de moyens. À condition d’avoir les bons outils, les bonnes compétences, et… les bons alliés.
C’est dans cette effervescence que s’inscrit le Salon International du Contenu Audiovisuel (SICA). Sa troisième édition, à laquelle j’ai eu le privilège de prendre part à Abidjan, les 26 et 27 juin 2025, fut un signal fort pour l’avenir du secteur. Le SICA est une véritable plateforme de développement du capital humain, indispensable à l’essor d’une industrie durable. Il offre aux jeunes professionnels africains l’opportunité d’apprendre, de se former, de confronter leurs idées au marché, mais aussi de bâtir des ponts entre créativité et stratégie.
J’ai eu l’honneur d’y contribuer en tant que keynote speaker lors des deux premières éditions des petits déjeuners de la RTI, moments clés de réflexion collective autour des enjeux de structuration du secteur. Cette troisième édition a également vu la présence de figures importantes de la production mondiale, à l’image de Larry Kasanoff, producteur de films emblématiques comme Terminator 2, Mortal Kombat, Platoon ou encore le clip Thriller de Michael Jackson et de grands studios d’animation japonais. Leur présence confirme l’intérêt qui grandit pour le potentiel africain.
Et c’est précisément ce dont l’Afrique a besoin aujourd’hui : multiplier ce type de dispositifs, partout sur le continent, pour construire un écosystème où la formation, la transmission et l’intelligence collective deviennent les fondations de la compétitivité culturelle.
Contenus audiovisuels en Afrique et politiques publiques : enclencher le levier de l’économie créative
Dans ce contexte, une question se pose : qui accompagnera cette vague ? Qui prendra le pari du long terme ? Les gouvernements africains doivent désormais sortir de la logique du symbole et entrer dans celle de la stratégie. Le cinéma et l’audiovisuel ne sont pas un luxe culturel. Ce sont des secteurs économiques à fort impact. Chaque film produit, chaque série diffusée, chaque contenu exporté est une source de revenus, d’emplois, d’image. Il est urgent d’investir dans la formation, de créer des fonds d’amorçage, de bâtir des studios publics-privés, de moderniser les législations sur la propriété intellectuelle.
Des initiatives existent. L’Union africaine, avec sa Commission du cinéma, trace une ligne politique continentale. Le fonds de 1 milliard de dollars lancé par Afreximbank, via FEDA, vise à soutenir les films africains, du financement à la distribution. Mais cela ne suffira pas sans une implication directe des États, qui doivent inscrire l’économie créative dans leurs plans nationaux de développement.
Mais les banques et les institutions financières doivent aussi suivre le mouvement. Elles doivent apprendre à mieux comprendre la logique économique des industries créatives et à adapter leurs outils de financement à la réalité du secteur. Il est temps de miser sur de grandes productions africaines ambitieuses, capables de porter nos récits au-delà de nos frontières et d’imposer une signature continentale. Cette ambition appelle à la fois des investissements lourds et une vision collective.
Au-delà des initiatives continentales et des fonds conséquents, le véritable levier repose sur une volonté politique claire et une mobilisation coordonnée à l’échelle nationale. Chaque pays africain doit concevoir l’audiovisuel comme un secteur stratégique, capable de générer des retombées économiques tangibles et d’affirmer son identité culturelle sur la scène mondiale. Cela implique de mettre en place des structures publiques dédiées, des incitations fiscales adaptées, et surtout d’investir massivement dans la formation professionnelle et technique. Sans cette approche intégrée, les promesses du marché resteront fragiles et les opportunités, inexplorées.
Pour la jeunesse africaine, l’audiovisuel représente un véritable levier entrepreneurial. Accessible, dynamique et en pleine mutation, le secteur offre de nombreuses opportunités, à condition de combiner créativité, vision économique et compétences techniques. Or, dans un univers numérique en constante évolution, la formation devient incontournable. D’ici 2030, 650 millions d’Africains devront être formés aux compétences digitales, et une partie d’entre eux pourrait faire de la culture numérique un véritable moteur d’émancipation professionnelle.
Takeaway : Ce qu’il faut retenir
- L’industrie audiovisuelle africaine est en pleine expansion et offre un potentiel économique majeur, avec une croissance attendue à l’échelle mondiale et continentale.
- Le capital humain est la clé de voûte de cette transformation : former, accompagner et professionnaliser les jeunes talents est indispensable pour bâtir un écosystème solide.
- Il est urgent de créer et multiplier des plateformes dédiées, véritables tremplins pour l’apprentissage, la formation pratique et le développement professionnel des jeunes créateurs africains.
- Les gouvernements africains doivent dépasser la simple symbolique et inscrire l’audiovisuel dans leurs stratégies nationales avec des politiques adaptées, un soutien financier ciblé, et des réformes législatives.
- Les entrepreneurs, notamment les jeunes, ont un rôle moteur à jouer : il s’agit d’investir, d’innover, de professionnaliser la création et la diffusion pour conquérir les marchés locaux et internationaux.